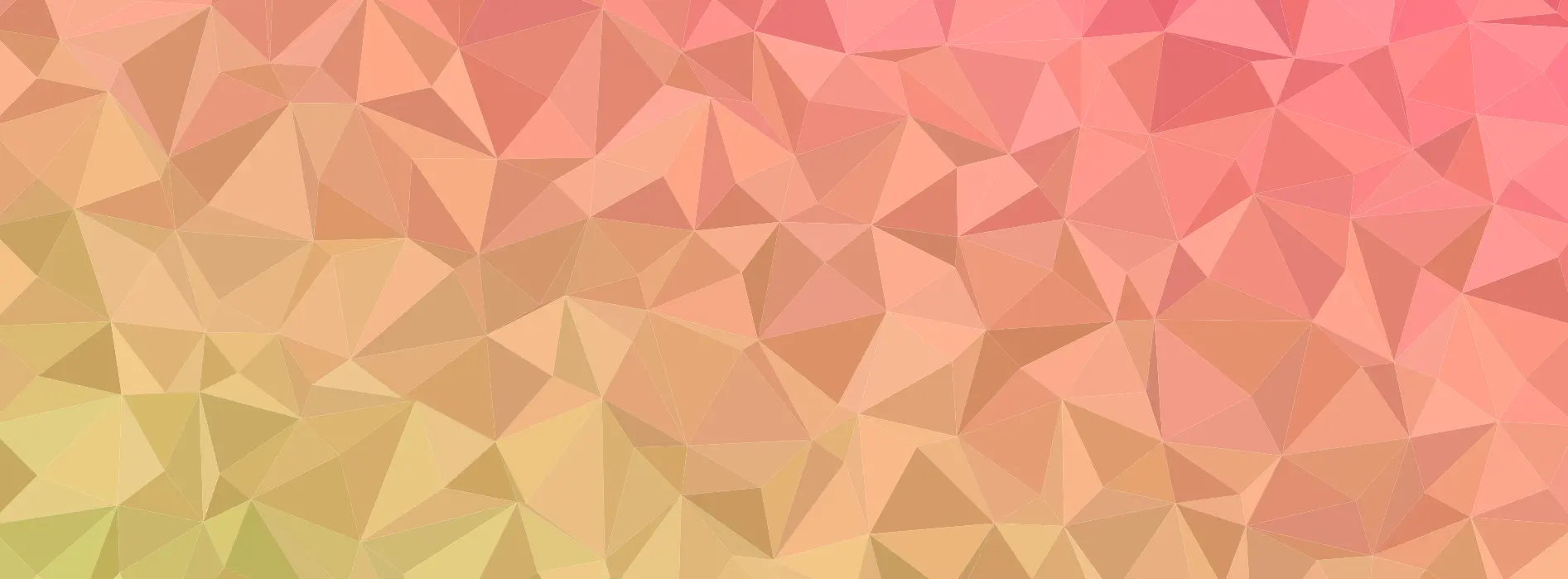Aujourd’hui j’ai envie d’évoquer la place centrale que peut occuper la figure maternelle dans la littérature, et dans le genre autobiographique surtout. Certains lui ont consacré un livre entier, ceux sont eux dont on va parler ici. Et d’autres, ont rendu hommage à leur mère dans la fiction, avec une distance respectueuse et pudique. Le meilleur exemple reste celui de Marcel Proust. Il émaille toute la Recherche de portraits en filigranes de sa mère, cachée derrière le paravent de la fiction.
La mère prend toute sa place avec des textes dédiés depuis la fin du XIXe siècle. C’est l’un des points d’aboutissement d’exploration de l’intime. Exploration lancée par le mouvement romantique dont les représentants ont mis au centre du jeu, le Je. Mais il y a plus intime encore que de se raconter au public.
C’est raconter sa maman. La mère de l’artiste, inconnue, parfois éloignée elle-même de l’art. Anonyme qui parfois accède tout de même à une forme de célébrité par ce que l’enfant en écrit.
La promesse de l’aube – Romain Gary
Bien sûr, je commence par ce texte majeur de Romain Gary ! L’œuvre à la gloire de la mère par excellence. Alors, d’abord, il faut rappeler que l’auteur a désigné ce récit comme une autofiction et non comme une autobiographie. Faut-il le croire sur parole ? Faut-il y voir une volonté pudique ? Est-ce la meilleure manière d’entretenir le mystère pour tous ceux qui espèrent tout connaître de Romain Gary ?
Pour autant, La promesse de l’aube est une déclaration d’amour d’un fils à sa mère. Dans une relation fusionnelle, peut-être parfois étouffante, le lecteur découvre cette femme, mère totale. Totale dans le sens où le narrateur ne sait pas grand chose de sa vie avant la maternité, ni même des autres aspects de sa vie à côté de son rôle de mère. Comme si la maternité avait pris le pas sur tout le reste.
Le portrait qu’il dresse de sa mère est complexe. L’on rencontre une femme délaissée par le père de son unique fils, et qui reporte sur lui toutes ses aspirations, ses ambitions. Elle donne tout pour lui, fait tout pour lui. L’émigration en France pour permettre à son fils de faire de meilleures études et de rêver à de prestigieuses carrières. C’est la figure sacrificielle de la mère, s’oublier, s’effacer pour porter l’enfant sur un piédestal.
Mais elle ne veut pas se sacrifier “pour rien”. Son fils est promis aux plus hautes fonctions, il ira loin, et elle l’élève dans cette croyance et cette perspective. Comme la mère d’Alexandre le Grand en son temps.
Et il semblerait que cela fonctionne comme méthode éducative 😉 Compagnon de la Libération, écrivain célèbre de son vivant, brillant diplomate… Et cette déclaration d’amour filial, passé la postérité.
Le livre de ma mère – Albert Cohen
Voici un autre texte rendant les hommages à la mère. Mais ce texte est marqué par l’expérience traumatique du deuil. Il y a la volonté cathartique d’extérioriser cette douleur violente et de fixer pour l’éternité la mère perdue. Comme Gary, c’est aussi la configuration de la relation entre un fils unique et sa mère entièrement dévouée. Des femmes indépassables, dont le dévouement sans limite et l’aide sans faille ne se retrouvent pas, pour deux hommes qui ont eu leur lot d’aventures amoureuses.
C’est un texte en prose mais il y a une réelle sensibilité poétique. Poésie qui est niée pourtant, l’auteur nous laisse quelques méchantes lignes contre les poètes trop snobs et “fainéants”. Pour autant, Albert Cohen a écrit une élégie. Un long cri de douleur empreint de la mélancolie du passé avec sa mère qui n’est plus. Cette poésie en prose est encore renforcée lorsque l’auteur évoque sa mère en entamant chaque paragraphe de l’expression “Amour de nos mères”. S’ouvre alors une litanie magnifique de souvenirs entrelacés à la peine du deuil.
L’élévation de sa mère passe aussi par le choix de la considérer comme une figure déifiée. A la fois l’auteur se présente comme athée et à la fois il désigne sa mère comme son unique croyance. Il évoque de nombreux souvenirs où elle le bénissait, sa figure naÏve, gentille et dévouée corps et âme renvoie aux panégyriques de saints catholiques. Et finalement, l’auteur nous livre sa version de la prière du Notre Père. Une version pour sa mère, pour toutes les mères.
Malgré le vocabulaire parfois familier ou argotique et malgré une impression “sur le vif”, ce texte n’a rien d’une écriture laissée au hasard de la plume. La construction, le chapitrage, tout a été pensé, poli, choisi. C’est ainsi que l’auteur passe du cri bestial à l’élégie, et assure la postérité de ce court texte bouleversant.
Sido – Colette
Avec le cours texte Sido, Colette laisse aussi la trace de sa mère. Mais ce n’est pas le même type d’intention que les deux récits précédents. D’abord parce que ce texte évoque sa mère certes, mais ensuite son père et ses deux frères. C’est donc un portrait de sa famille. De plus, le texte est très court. Ainsi, oui, Colette nous donne à voir sa mère. Mais elle choisit pourquoi elle le fait et comment. Elle explique en toutes lettres au lecteur que c’est aussi pour donner des éléments à ses biographes qui racontent plus ou moins n’importe quoi sur sa mère. Il s’agit donc de rétablir la vérité, en vue de la postérité de l’autrice. Il y a donc déjà la conscience de l’après, et cela influence forcément ce qu’elle dit de sa mère.
Elle nous en fait le portrait par touches, comme un carnet de croquis. Les images mentales de souvenirs précis de l’enfance auprès de Sidonie viennent prendre forme par l’écriture. On découvre une femme entière, passionnée par la nature et les fleurs, proches de ses enfants, amoureuse de son mari. Mais pas plus. Resteront dans l’ombre la vie avant la maternité, les inspirations propres et tant d’autres choses. J’ai eu la même sensation qu’avec la correspondance de Jane Austen. A sa mort, sa sœur Cassandra a caviardé les lettres, pour préserver les secrets les plus personnels de l’autrice. Il me semble que Colette a fait quelque chose de semblable.
Certes, elle pouvait en rien dire du tout sur sa mère et sa famille. Mais elle a jugé qu’elle pouvait nous partager quelques éléments. Lui rendre hommage, sans la trahir, sans étaler sa vie privée ni sa vie familiale. Et les instantanés qui forment Sido, nous révèle toutefois puissamment cette femme.
Ce sont trois textes magnifiques, bouleversants chacun à leur manière. Tous servis par une écriture ciselée et l’amour de l’enfant qui se cache derrière les auteurs et l’autrice. Et beaucoup d’autres artistes consacrent des textes à leur mère. Je ne détaille pas à nouveau ici Monique s’évade de Edouard Louis, livre sur lequel j’ai déjà publié un post. Mais je pense à Annie Ernaux avec Une femme ou bien Julia Deck et son Ann d’Angleterre récemment publié. C’est beau et intéressant de voir ces adultes se retourner et nous livrer leur version de leur relation avec la mère ❤️